
Simone de Beauvoir.
L’Amérique au jour le jour 1947.
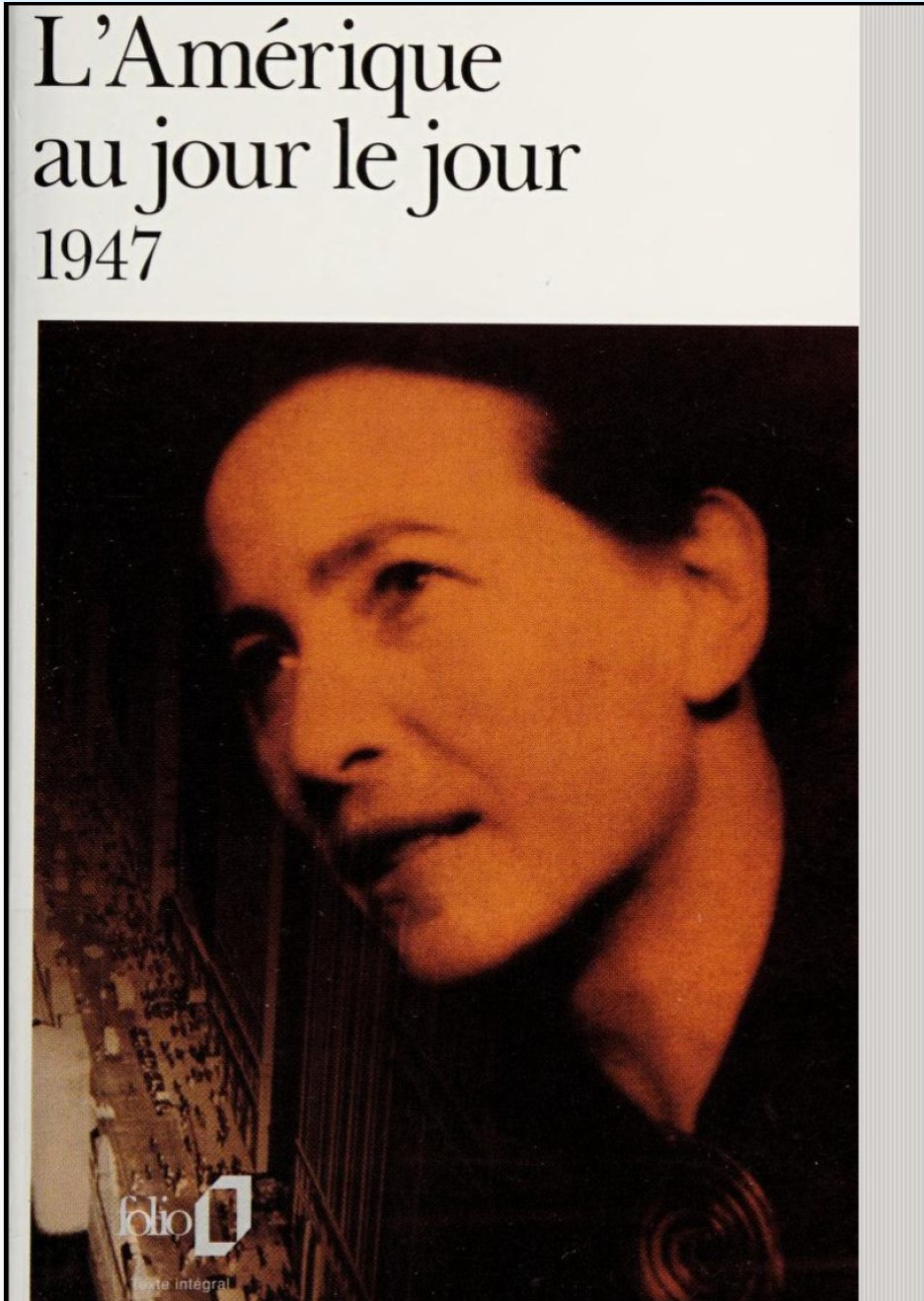
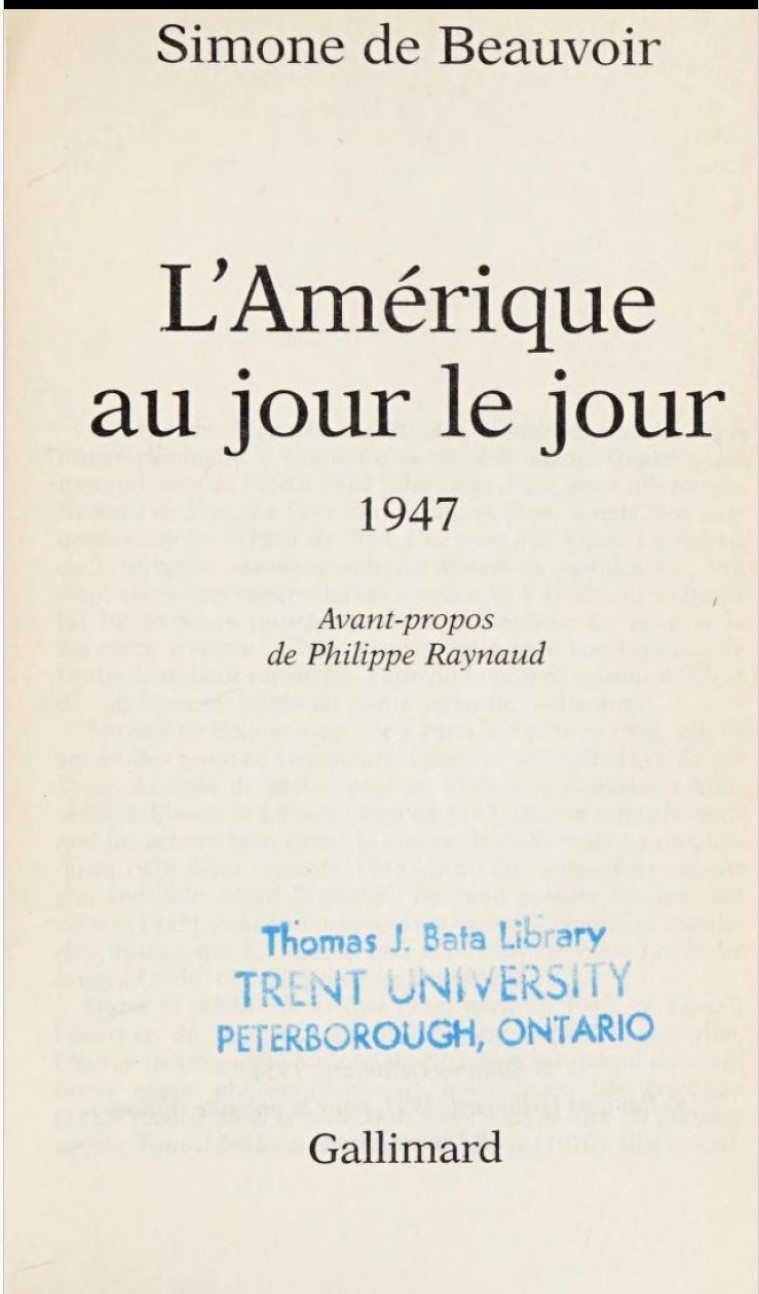
au jour le jour
1947
Avant-propos
de Philippe Raynaud
TRENT UNIVERSITY
PETERBOROUGH, ONTARIO
Gallimard
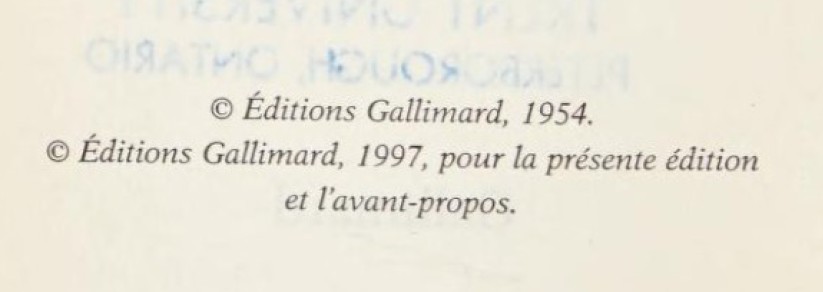
©Éditions Gallimard, 1954.
©Éditions Gallimard, 1997,
pour la présente édition
et l’avant-propos.
Simone de Beauvoir a écrit des Mémoires où elle nous donne elle-même à connaître sa vie, son œuvre. Quatre volumes ont paru de 1958 à 1972: Mémoires d’une jeune fille rangée, La force de l’âge, La force des choses, et Tout compte fait, auxquels s’adjoint le récit de 1964, Une mort très douce. L’ampleur de l’entreprise autobiographique trouve sa justification, son sens, dans une contradiction essentielle à l’écrivain: choisir lui fut toujours impossible entre le bonheur de vivre et la nécessité d’écrire; d’une part la splendeur contingente, de l’autre la rigueur salvatrice. Faire de sa propre existence l’objet de son écriture, c’était en partie sortir de ce dilemme.
Simone de Beauvoir est née à Paris le 9 janvier 1908. Elle fit ses études jusqu’au baccalauréat dans le très catholique Cours Désir. Agrégée de philosophie en 1929, elle enseigna à Marseille, à Rouen et à Paris jusqu’en 1943. Quand prime le spirituel fut achevé bien avant la guerre de 1939 mais ne paraîtra qu’en 1979. C’est L’Invitée (1943) qu’on doit considérer comme son véritable début littéraire. Viennent ensuite Le sang des autres (1945), Tous les hommes sont mortels (1946), Les mandarins, roman qui lui vaut le prix Goncourt en 1954, Les belles images (1966) et La femme rompue (1968).
Outre le célèbre Deuxième Sexe, paru en 1949, et devenu l’œuvre de référence du mouvement féministe mondial, l’œuvre théorique de Simone de Beauvoir comprend de nombreux essais philosophiques ou polémiques, tels Privilèges (1955, réédité dans la collection Idées sous le titre du premier article, Faut-il brûler Sade?) et La vieillesse (1970). Elle a écrit, pour le théâtre, Les bouches inutiles (1945) et a raconté certains de ses voyages dans L’Amérique au jour le jour (1948) et La Longue Marche (1957).
Après la mort de Sartre, Simone de Beauvoir a publié La cérémonie des adieux (1981) et les Lettres au Castor (1983) qui rassemble une partie de l’abondante correspondance qu’elle reçut de lui. Jusqu’au jour de sa mort, le 14 avril 1986, elle a collaboré activement à la revue fondée par Sartre et elle-même, Les Temps modernes, et manifesté sous des formes diverses et innombrables sa solidarité totale avec le féminisme.
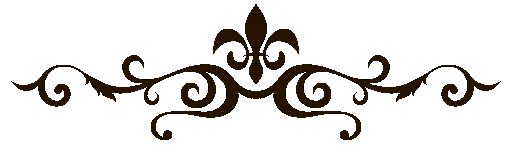
Je pars demain matin avec N. pour une randonnée en autobus d’environ trois semaines qui me ramènera à New York en passant par le Sud. Ce soir, ce sont nos adieux à Los Angeles. Un screen-writer ami d’I. a organisé une party. Un autre ami qui est marchand de disques et spécialiste du jazz a apporté les pièces les plus intéressantes de sa collection: des vieux blues de la Nouvelle-Orléans, des funérals, des Bessie Smith, des Louis Armstrong. Au long de la soirée, c’est toute une vivante histoire du jazz qui se déroule. On m’explique à nouveau la différence entre le style New Orleans et le style Chicago; l’explication n’est jamais tout à fait la même; mais c’est que nécessairement elle est analytique: comment dire avec des mots ce qui distingue Léonard de Vinci de Luini ou Vermeer de Delft de Pieter de Hooch? Il y faudrait en tout cas beaucoup de temps. Quand on entend les disques cependant, les deux écoles se distinguent d’une façon bien tranchée, même pour un profane. Tout en écoutant, nous dînons, nous causons, nous buvons. À la fin du repas arrive S. que je n’avais pas revu depuis la Death Valley. Aujourd’hui, il n’est plus du tout vêtu comme un cowboy: il porte un complet sombre avec à la boutonnière un gros œillet blanc qui lui donne l’air d’un marié de village. Dès qu’il nous voit, il nous serre N. et moi, passionnément contre son cœur: comme nous nous sommes amusés! Comme il m’est reconnaissant de lui avoir permis de revoir Lone Pine! Il faut que je revienne à Los Angeles afin que nous montions en haut du mont Whitney. Je suis bien contente: je croyais qu’il avait gardé un souvenir piteux de cette expédition. Mais il a eu l’impression de goûter à la liberté, c’est assez.
Je fais aussi la connaissance de Wyler — le metteur en scène de la Vipère et Best years of our life. Il est Autrichien d’origine et il parle très bien le français; on le sent beaucoup plus Européen qu’Américain. Il me donne des détails intéressants sur la façon dont son dernier film a été tourné; il y a entre autres un moment très beau où Danna Andrews, assis dans la carlingue d’un vieil avion à demi démoli, se rappelle son passé de pilote; Wyler avait d’abord évoqué ces souvenirs en surimpression; puis il a supprimé ces images et gardé seulement le fond sonore qui les accompa- gnait; enfin, il s’est refusé même ce secours; il a demandé à la seule image d’une nuque, d’une vitre, d’un ciel, d’exprimer à la fois passé et présent; et il a obtenu en effet cette réussite singulière: il a photographié le passé dans le présent. Je cause ensuite avec Man Ray dont j’ai tant aimé naguère les films et les photographies. Lui aussi a l’air tout à fait dégoûté de Hollywood où bien entendu les recherches poétiques qui l’intéressaient sont impossibles. Il est marié avec une jeune femme brune qui a l’air d’une Arabe; elle porte des pantalons de soie noire avec une veste brochée, et elle danse magnifiquement; je crois qu’elle a fait de la danse en professionnelle. Il y a d’autres femmes très jolies. Le temps passe si vite que je suis tout étonnée d’apprendre qu’il est 2 heures du matin. Mais N. me dit que les parties de Hollywood sont loin de tout ressembler à celle-ci: généralement rien de plus insipide que ces réunions où personne n’a rien à dire à personne et où tout le monde boit en attendant le moment de partir.
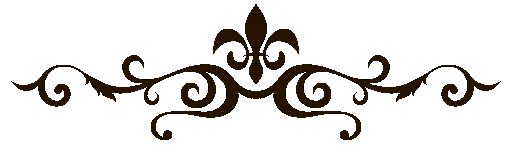
29 mars.
Terres noires, forêts tropicales, mousses espagnoles, bayous: voici la dernière étape avant la Nouvelle-Orléans où nous passerons quatre jours. Je lis avec passion pendant que l’autobus roule le Voyage sur le Mississipi de Mark Twain et, à chaque rivière, je demande: Est-ce le Mississipi? C’est toujours lui, et ce n’est jamais lui tout entier: seulement une branche de ce delta indéfiniment ramifié.
M’entendant parler français, une femme m’aborde à un des arrêts. «C’est bien le français que vous parlez?» Elle m’invite à m’asseoir à côté d’elle dans le car. Elle est Bretonne, mais installée depuis vingt ans dans une ferme de la Louisiane; la vie d’ici lui plaît et elle me montre avec fierté une photo de sa fille qui est étudiante dans une Université. Un peu plus loin, un homme m’adresse la parole dans un jargon que je ne comprends pas et où revient sans cesse le mot «gare»; je finis par deviner qu’il parle français lui aussi, le français que la Louisiane a hérité du XVIIIe siècle et qu’il me demande si j’ai eu des frères tués à la guerre. Notre Greyhound est bien différent de celui qui traversait, presque vide, les déserts d’Arizona et du Nouveau-Mexique. Maintenant, il y a des queues aux stations qui se dressent toutes au cœur de quelque ville; les noirs, pour qui souvent aucun abri n’a été aménagé, attendent dehors, parfois sur des bancs, ordinairement debout, que la race supérieure se soit installée dans le bus: quatre ou huit places leur sont réservées sur la banquette du fond; ils n’effectuent souvent que de courts trajets; ce sont des habitants de ces campagnes qui se déplacent d’un village à l’autre; quand ils sonnent pour arrêter la voiture, c’est avec un mélange de mauvaise humeur et d’ironie que conducteur et voyageurs les regardent se faufiler à travers le couloir central. Les blancs, bien entendu, voyagent debout plutôt que de s’asseoir à côté des noirs si par hasard il reste une place libre parmi eux. Plusieurs de ces blancs parlent un vieux français qui m’est plus inintelligible que l’anglais. Dans les villages que nous traversons, on lit au-dessus des épiceries, des magasins de confection, des salons de coiffure les noms «Mathieu, Debureau, Lefèvre, Boucher, Robert»; il n’y a presque que des noms français. À la nuit tombée, l’autobus s’arrête pour le dîner dans une petite ville au bord du multiple Mississipi; nous commençons à détester ces stations d’autobus où l’on mange des viandes noires, où les juke-boxes jouent du Sinatra et du Crosby, où les rest-rooms sont composés de stalles qu’aucune porte ne défend contre les regards, où les noirs sont parqués dans des réduits sans fenêtres. Il pleut doucement, mais nous allons nous promener dans une allée au sol détrempé qui longe le fleuve: on aperçoit à droite, à gauche, les hautes forêts solitaires qui emprisonnent ses eaux; sous le ciel mouillé, il est noir, triste et mystérieux.
Je regarde le fleuve, je pense à Cavelier de la Salle, qui mourut, assassiné par ses hommes, pour avoir confondu entre eux les bras de ce delta multiple et monotone; venu de France avec quatre vaisseaux pour fonder glorieusement la Louisiane, il échoua à reconnaître l’authentique embouchure de ce «Père des Eaux» qu’il avait une fois déjà périlleusement descendu et s’égara avec ses compagnons sur la côte ingrate. Ce fut un agent de la Compagnie des Indes, M. de Biéville qui, en 1718, fonda la ville qu’en l’honneur du Régent on appela la Nouvelle-Orléans. Son homonyme française fut écumée en sa faveur: des archers aux ordres de Law et de son gang enlevérent à travers les rues les femmes de petite vertu et sans doute emportèrent-ils même dans leurs charrettes d’honorables citoyennes. En 1763, la Louisiane, qui comprenait alors une grande partie de la vallée du Mississipi, fut cédée à l’Espagne qui avait reconnu aux Américains le droit d’entreposer leurs marchandises à la Nouvelle-Orléans; en 1802, la colonie fut rendue à la France en échange de la Toscane; Jefferson fit proposer à Talleyrand 50 millions de francs pour la Nouvelle- Orléans et la Floride: il leur vendit pour 60 millions la Louisiane entière, ce qui garantissait à l’Amérique la libre navigation du Mississipi et lui permettait de s’étendre vers l’Ouest en toute sécurité.
Longtemps encore nous roulons dans la nuit. De loin en loin, des lumières s’allument, mais ce n’est qu’un poste d’essence perdu au milieu du delta. Des miles et des miles de nuit humide, des ponts, des eaux sombres, d’autres ponts, d’autres eaux, la même nuit, et voici qu’enfin les lumières s’agglomèrent. Maintenant ce sont des avenues, des carrefours, et d’autres avenues et d’autres carrefours, des faubourgs et d’autres faubourgs. Et enfin voici Broadway, voici Market Street: la grande rue illuminée, grouillante qui porte ici le nom de Canal Street. Cette ville, demain matin, ce sera la Nouvelle-Orléans.
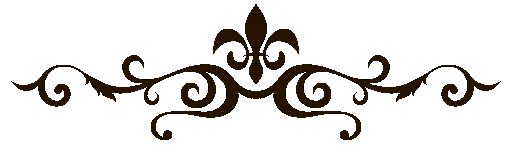
30 mars.
À chaque fois, je me sens écrasée par l’horrible opulence des grands hôtels américains: on pourrait y vivre toute une existence sans en jamais sortir: fleuristes, confiseurs, libraires, coiffeurs, manucures, dactylos, sténographes sont à votre service; il y a dans celui-ci quatre espèces de restaurants, bars, cafés, dancings; c’est une zone neutre, comme les concessions internationales au cœur de capitales colorées.
Mais il suffit de traverser la rue, et nous voilà au cœur de New Orléans, dans le Carré français. La vieille ville coloniale a été bâtie en damier comme les cités modernes; mais ses rues étroites sont bordées de maisons d’un ou deux étages qui évoquent à la fois l’Espagne et la France; elles ont la sérénité de l’Anjou, de la Touraine, mais les beaux balcons de dentelle verte font songer aux balcons de Cordoue et aux grilles de fer forgé qui condamnent les fenêtres des palais arabes; une chaleur andalouse pénètre le silence provincial. L’exotisme ici n’est plus mexicain ou indien: il est français. Sur les dalles du vieux cimetière, au coin des rues, au-dessus des magasins les noms français ont des résonances antiques; et voilà que dans les curios-shops au lieu de tomahawks et de masques indiens on vend des lampes à pétrole, des vases de Sèvres, vestiges d’une civilisation aussi reculée que celle des Hopi et des Navajo: les franges de perles sont des bandeaux barbares, les lustres et les potiches, d’étranges idoles. Beaucoup de vieilles demeures ont des légendes: voici la maison du maréchal-ferrant, celle où vécut le pirate Jean Laffitte, celle où ne vécut pas Napoléon bien qu’elle lui ait été destinée et qu’elle porte abusivement son nom; non loin, c’est la maison de l’absinthe. Toutes ont été transformées en bars qui sont paisibles et vides dans le soleil matinal.
Il y a plusieurs rues où une porte sur deux ouvre sur un bar ou une boîte de nuit. Dans ce coin-ci on ne vend que des livres: achats, ventes, occasions; les magasins sont minuscules et débordent sur le trottoir, offrant au passant des boîtes pleines de vieux volumes dépareillés. Encore des curios-shops et des confiseries avec leurs parterres de pralines: devant la porte une grande négresse en carton, un foulard noué autour de la tête, sourit en désignant un air gourmand cette spécialité créole. Nous visitons un petit théâtre qui est demeuré inchangé depuis le XVIIIe siècle et où on joue de temps à autre une pièce française. Et nous débouchons sur une place simple et pure comme la place des Vosges, à Paris. Tout le luxe des vieilles maisons sobres réside dans les riches treillis de fer forgé, d’un vert tendre et chaud, qui courent le long des terrasses. Un petit musée ressuscite la vie coloniale des siècles perdus: maisons en miniature avec leur mobilier nain, poupées portant des toilettes de cérémonie, et plus près de nous, sur de vieilles photographies, des groupes et des portraits; on peut voir aussi les bijoux, l’argenterie, les robes, les porcelaines, des familles les plus notables du passé. Nous suivons encore des rues silencieuses et nous arrivons au marché au poisson: ici le présent reprend ses droits, la vie renaît. Les boutiques sont des bazars bruyants, une foule se bouscule sur les trottoirs; le café où nous mangeons des beignets est grouillant de monde. L’éventaire du marchand de fruits et de légumes avec ses bâches poussiéreuses, ses bananes malingres, ses salades souffreteuses, ses poires demi-blettes, semble importé de la rue Mouffetard; ce n’est plus la splendeur égale des fruits de serre: les poires, le raisin, le marchand et ses clients participent à la même vie difficile et précaire. À travers les docks nous nous avançons jusqu’aux eaux du Mississipi: entre les maisons et les usines, c’est un fleuve pareil à beaucoup d’autres.
Le Carré est au cœur de New Orleans comme une blanche et dure amande; mais la pulpe généreuse et meurtrie qui s’épanouit autour de ce noyau a un goût plus capiteux. Tout l’après-midi nous nous sommes promenées à pied et en taxi sur les larges avenues concentriques, au bord du canal, dans les cimetières, dans les parcs et sur la rive du lac. Je voudrais marcher pendant des jours au long de ces allées. Elles sont bordées de ces maisons romantiques dont j’ai aimé à San Antonio les pignons, les colonnes, les porches, les vérandas; beaucoup de ces demeures sont centenaires et le temps a rendu à leurs architectures de bois une trouble vie végétale: elles ont la couleur des lichens et des mousses. Elles sont souvent entourées de jardins aux frondaisons capricieuses; dans aucun de ces édens privés le printemps n’est si magnifiquement exalté que sur les avenues publiques où se déploient à l’infini des parterres d’azalées. En France, ce sont des fleurs ennuyeuses qu’on voit en pots chez les fleuristes, dont on fait cadeau à sa grand-mère pour sa fête ou qui, mêlées de rubans roses, décorent les salles de banquets. Et voilà que ce sont de vraies fleurs; en buissons échevelés, sauvages comme les ronces des bois, comme les chèvrefeuilles des haies, elles répandent à travers la ville le luxe des reposoirs, des salles de fête, des serres chaudes; elles n’ont pas d’odeur; on dirait que leur couleur trop vive, trop achevée, a absorbé leur parfum. La pénétrante odeur qui rôde dans les allées en fête, c’est l’odeur de l’automne. Les arbres dont les bourgeons éclatent à peine perdent déjà leurs feuilles, elles tombent en pluie dorée sur les azalées, elles recouvrent les trottoirs d’une jonchée mouillée et odorante comme une forêt en octobre. Sur la soie printanière des fleurs, sur la pourriture automnale des feuilles moribondes pèse un ciel d’été orageux, d’un gris lumineux et moite.
Nous ne voulons pas que New Orleans nous échappe; nous ne voulons pas que le secret de ses nuits nous demeure caché. Dans la rue du vieux Carré que nous arpentons au soir tombant, nous voyons annoncés des orchestres mexicains, hawaïens, des danseuses nues, des girls; mais ce que nous désirons c’est entendre du vrai jazz joué par des noirs; ou n’y en a-t-il plus en Amérique? Je décide de téléphoner à des gens dont on m’a donné les noms à Los Angeles; j’ouvre l’annuaire: je découvre vingt John Brown, douze G. David, autant de B. Smith. J’essaie au hasard: à l’autre bout du fil des voix méfiantes s’étonnent. J’essaie quatre ou cinq fois sans succès. J’abandonne. Il faudra nous frayer seules notre chemin. Avec toute la sagacité dont nous sommes capables nous consultons le petit guide touristique qu’on distribue au bureau de l’hôtel. Notre premier choix est heureux. Le restaurant du Vieux Carré où nous allons dîner nous enchante: la salle est décorée de peintures naïves qui représentent des bateaux voguant sur une mer gaufrée; et suspendus au plafond, trônant sur la cheminée, voici des frégates en miniature avec leurs voiles et leurs gréements; au fond s’ouvre un patio sombre, dont les tables sont cachées parmi les arbres et discrètement éclairées par des lampes individuelles. On nous sert une cuisine créole de grand style. De temps à autre on voit trembler dans la nuit la flamme bleue d’un «brûlot» dont la glace fond lentement parmi les vapeurs embrasées d’un alcool au goût de cerise.
Le Carré français commence à s’animer; des grooms galonnés sont postés aux portes des nightclubs; les portes des bars se sont ouvertes, on voit briller le whisky sur les comptoirs; on entend de la rue le cliquetis des verres, la voix des phonographes. Où aller? Nous entrons dans la «maison de Napoléon» dont nous aimons le décor de bois sombre; mais il n’y a pas de jazz. Le patron est très aimable parce que nous sommes Françaises et nous lui expliquons que nous voulons entendre un bon jazz noir; une ombre passe sur son visage: la situation est très tendue depuis quelque temps entre noirs et blancs, les noirs ne veulent plus jouer pour des blancs. Cependant, il nous conseille d’essayer de l’Absinthe House. C’est une des demeures présumées du pirate Jean Laffitte; la première salle est un petit bar dont le plafond et les murs de bois sont entièrement tapissés de vieilles cartes de visite et de billets de banque de tous les pays; dans la seconde pièce, quelques tables et une estrade avec trois musiciens noirs: piano, guitare et basse. Tout de suite, nous sommes prises; cette musique ne ressemble en rien à celle de Cafe Society, ni même à celle de Harlem: les trois noirs jouent avec passion, pour euxmêmes. Le public est peu nombreux, il n’est pas élégant; à vrai dire, ce n’est pas un public mais quelques vieux couples, quelques familles sans doute de passage à New ant: si déplacées ici qu’il n’y a pas à tenir compte de leur présence: l’orchestre ne cherche ni à les ménager ni à les éblouir, il joue comme il lui semble bon de jouer; si la contrebasse — un jeune noir qui n’a que dixhuit ans en dépit de sa corpulence — ferme parfois les yeux avec un air peraäu, ce n’est pas une mimique servile: il n’obéit qu’à la musique et aux mouvements de son cœur. Juste à côté de l’orchestre il y a deux blancs, très jeunes, aux cheveux noirs, qui écoutent avec une attention religieuse et qui entre les morceaux rient amicalement avec les musiciens. Ils sont très différents des autres clients: ils nous font penser au «jeune homme à la trompette» de Dorothy Baker; ils sont sans doute de ces jeunes gens qui étouffent dans la civilisation américaine et pour qui la musique noire est une porte d’évasion. Ils nous regardent autant que nous les regardons car notre présence aussi doit avoir quelque chose d’insolite. Cependant, nous buvons avec délices de grands zombies. Ce cocktail redoutable est originaire de New il porte le nom de ces morts-vivants qui sont les héros de tant de thrillings et dont la légende est née aussi dans le Sud; on m’a dit que plus d’un adulte civilisé et cultivé de Louisiane ou de Géorgie croit encore en l’existence de ces fantémes tourmentés: il faut percer avec une épée la poitrine du cadavre pour lui assurer le repos éternel. Le cocktail zombie est considéré comme si violent qu’en beaucoup d’endroits il n’est pas permis d’en servir plus d’un par client; en vérité, il est inférieur à sa réputation; pas plus qu’à Los Angeles nous n’en sentons les effets.
Notre amitié avec les jeunes gens bruns fait des progrès: ensemble nous applaudissons avec le même feu, nous échangeons quelques mots et les voilà assis à notre table. R. est d’origine italienne, C. Espagnol. Et le miracle c’est que R. est exactement le jeune homme à la trompette que nous imaginions. De famille misérable, il s’est engagé il y a cinq ans dans la marine et il fait partie comme trompette de la musique militaire: il a encore un an à tirer, et il désire ardemment devenir alors définitivement un musicien; il a un peu étudié au Conservatoire de Philadelphie qui lui semble pour cette raison la plus merveilleuse ville d’Amérique. Il parle avec passion non seulement du jazz mais de Stravinsky, de Ravel, de Béla Bartok. Il a peu lu mais le livre qu’il préfère à tout autre c’est Ulysse de James Joyce. Il a vingt-deux ans. De tous les jeunes gens de cet âge que j’ai rencontrés en Amérique, c’est le premier qui soit jeune.
À New York, il lui serait possible d’apporter sa trompette et de jouer avec ses amis noirs: ici, il n’en est pas question. Pas question non plus d’inviter les musiciens à boire un verre à notre table. Nous leur parlons de notre place. Ils sourient largement parce que nous sommes Françaises: deux d’entre eux ont des femmes françaises, c’est-à-dire qui descendent de familles noires de la Louisiane française, et qui parlent un français antique. Nous causons avec eux, nous leur demandons de vieux airs. Nous restons longtemps mais nous voudrions découvrir d’autres endroits encore. Les noirs nous supplient de ne pas emmener R. et C. avec nous: ils sont si heureux de jouer devant des gens qui aiment vraiment le jazz et qui comprennent. Nous nous faisons indiquer quelques adresses et nos nouveaux amis nous promettent de nous servir de guides le lendemain soir.
Nous sommes tout éblouies de notre chance; cette nuit bruyante ne nous intimide plus, nous l’avons apprivoisée; cette fois nous y participons, nous ne sommes pas dans le triste troupeau des exclus. L’Absinthe Barn ressemble à l’Absinthe House comme une sœur jumelle: mêmes cartes de visite et billets de banque aux murs du bar, même salle banale avec la même clientèle de passage; mais au lieu d’orchestre il n’y a qu’un pianiste; il joue bien, d’une manière un peu trop suave. À la table voisine, il y a un client à demi ivre qui égare sa main sur le dossier de nos chaises; jamais de pareils incidents ne se produisent en Amérique; N. n’a pas plutôt reculé son siège, que le patron a bondi et expulsé l’ivrogne; quand nous partons, il se confond en excuses, il nous supplie de croire que sa clientèle est correcte et que nous pouvons revenir en toute sécurité. Nous faisons un tour dans un autre bar où se réunissent, paraît-il, les artistes et la bohème de la ville; nous sommes frappées surtout par le grand nombre de pédérastes qui titubent au comptoir; il y en à un sournois, qui s’est attaqué à un jeune couple: il feint de courtiser la femme mais il s’arrange toujours pour s’écrouler sur l’épaule du mari. Une jeune noire, à moitié ivre, tient le piano et elle joue du vieux jazz dans le style le plus émouvant. C’est un grouillement de gens qui semblent tous imbibés d’alcool; mais ivresse et vices ont ici des couleurs faciles, l’atmosphère n’est pas lourde, elle nous semble fraîche et gaie: ou cette gaieté est-elle en nous? La nuit est tiède dans les rues sous un ciel d’un gris lumineux. Peu à peu les boîtes se ferment, mais nous n’avons pas envie de nous endormir quand nous nous sentons encore si vivantes. Nous nous asseyons au comptoir d’un bar misérable, grand ouvert sur la nuit, où un nain au visage café au lait tape frénétiquement sur un vieux piano; deux clochards dansent sur le trottoir. Quand ils s’en vont, quand le piano se tait et que nous ne trouvons plus rien à faire de nous-mêmes, nous nous résignons à regagner l’hôtel.
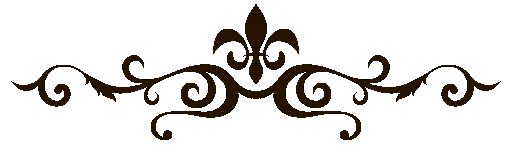
31 mars.
Nous nous promenons le matin aux mêmes endroits que la veille. À midi, nous mangeons de la cuisine créole dans un vieux restaurant français. Et nous prenons le bateau qui monte et descend sur quelques miles le Mississipi. Il y a quatre étages superposés et chacun d’eux est un bar, une cafeteria, ou un dancing. La nuit, il y a un orchestre et les gens dansent sur la vaste piste cirée. Le jour, ils sont simplement assis dans les fauteuils de cuir, ils boivent et ils regardent. À vrai dire, il n’y a pas beaucoup à voir. L’excursion est agréable à cause du soleil, du ciel, du bruit et de l’odeur de l’eau, mais le fleuve coule entre des usines et des entrepôts qui n’ont rien de remarquable. Le capitaine installé devant un microphone explique impitoyablement le paysage. Il s’agit toujours, comme aux chutes du Niagara, comme au Grand Canyon, de livrer aux touristes une nature «conditionnée», «homogénéisée» par un intermédiaire humain.
Nous dînons dans un patio différent de celui de la veille, mais aussi charmant. La couleur du ciel au-dessus de nos têtes nous surprend: il est gris perle, lumineux comme une aube, on dirait qu’il est éclairé par quelque phare mystérieux. Une fois dans la rue, nous comprenons: un tendre brouillard enveloppe la ville; les grands buildings de l’autre côté de Canal Street ont reculé de plusieurs milles; ils sont lointains, fantomatiques; la brume étouffe les enseignes au néon; mais elle forme au-dessus des toits un écran où se réverbèrent sourdement toutes les lumières de New le ciel est presque blanc, l’air moite. C’est une douceur suffocante, proche de l’orage et des larmes.
À l’Absinthe House, nous retrouvons nos amis. Nous sommes fières d’avoir ces amis et de nous sentir complices, non du public qui écoute avec hébétude, mais des musiciens. Il y a du monde ce soir: un groupe d’étudiants et d’étudiantes attentifs, des couples ennuyés et des parties joyeuses. À une des tables, un vieux monsieur se met à chanter: visage rose et frais sous de beaux cheveux blancs, lunettes cerclées d’or, assurance tranquille émanant d’un portefeuille bien garni, il appartient à un type courant et particulièrement détestable. L’orchestre l’accompagne complaisamment et il entonne une autre chanson; je m’indigne; le petit Italien sourit; il m’explique qu’un membre de l’assistance a le droit de chanter à la condition de payer: c’est tout bénéfice pour les musiciens. Et je vois, en effet, que le chanteur importun dépose des dollars sur le piano; il a une drôle de manière d’aimer la musique.
R. et C. voulaient nous amener dans un dancing réservé aux noirs où ils ont leurs entrées, mais c’est la Semaine sainte, New Orleanskst une ville catholique et pieuse et, ce soir, l’endroit est fermé. Ils nous conduisent simplement dans un autre bar du Vieux Carré où il y a un excellent jazz noir avec saxophone et trompette; le trompette est tout jeune, il joue avec toute sa jeunesse, avec un don de lui-même si total que sa vie entière semble engagée dans chaque note. C’est ici, dans ces boftes modestes, chez ces musiciens inconnus, que le jazz, plus qu’à Carnegie Hall où même au Savoy, atteint une vraie dignité: ni divertissement, ni exhibition, ni commerce, il est pour certains hommes un mode de vie et une raison de vivre: il a sur l’art, la poésie et sur la musique imprimée le pathétique privilège d’une communication immédiate et fugace comme les instants mêmes dont il transfigure la substance. Si la vie de ces hommes est souvent tourmentée, c’est qu’au lieu de tenir la mort à distance comme les autres artistes, ils réalisent minute par minute le mariage de l’existence et de la mort; c’est sur ce fond — sur fond de mort — que s’enlèvent les chorus inspirés du jeune trompette; et on ne peut pas l’entendre seulement avec ses oreilles et son cerveau: il propose une expérience dans laquelle il faut se couler tout entier. Il la propose: dans quel désert! les gens qui sont ici n’ont pas même le zèle respectueux des habitués des concerts; ils s’amusent du jazz et le méprisent du haut de leur dignité d’hommes blancs bien installés dans leur argent et leur moralité; c’est avec cette morgue que les grands seigneurs du passé s’’amusaient aux bouffons et aux histrions. R. interpelle le trompette, ils échangent quelques mots et le jeune noir s’illumine; en jouant, il nous regarde, il nous sourit: comme ceux de l’’Absinthe House, il sent le besoin de jouer pour quelqu’un et c’est une chance qui ne lui est pas souvent donnée.
Le jazz s’arrête. Une belle jeune femme aux cheveux noirs s’avance sur la petite estrade; elle commence à danser, et à dépouiller lentement ses vêtements selon les rites classiques des burlesques; dans un coin, une femme d’âge mûr la surveille d’un œil négligent: elle lui ressemble comme une mère, et on dit qu’elle est sa mère. On dit aussi que la danseuse est d’excellente famille, qu’elle a fait de fortes études, qu’elle est intelligente et cultivée; mais à New OÜrleans; on entoure volontiers les danseuses nues d’une auréole légendaire. Ce qui est certain, c’est que celle-ci est belle et attirante. Plus elle se dénude, plus les visages deviennent austères; ils expriment une curiosité détachée, polie et presque ennuyée; quand elle abandonne son slip, ne conservant autour des reins qu’un petit triangle pailleté retenu par un cordonnet de soie, l’atmosphère est si chargée de moralité qu’on se croirait au temple, un dimanche matin.
Nos amis veulent essayer de nous conduire au quartier noir. Un taxi nous transporte à l’autre bout de la ville. Nous entrons dans un petit dancing dont le patron qui connaît R. nous accueille amicalement; mais il n’y a pas d’orchestre aujourd’hui, à cause de la Semaine sainte, et les noirs qui sont assis dans le bar nous regardent avec des yeux hostiles; nous ne leur imposerons pas notre présence, nous partons; comme nous franchissons la porte, nous les entendons qui rient derrière nous, sans amitié. Dans la rue, les taxis refusent de s’arrêter; les uns disent «non», d’une voix ironique; d’autres s’excusent: nous aurions des ennuis si nous chargions des blancs. Et il est vrai qu’à New Drleansdies chauffeurs noirs n’ont le droit de travailler que pour des clients de couleur. Nous traversons donc à pied cette ville ennemie, cette ville où malgré nous nous sommes des ennemis, justement responsables de la couleur de notre peau et de tout ce que, en dépit de nousmêmes, elle implique. R. nous dit que, malgré le charme si profond de New Orleans,jl ne pourrait supporter de vivre ici, à cause de l’odieuse discrimination raciale, et qu’il regagnera le Nord aussitôt que possible.
Nous marchons longtemps. Le rose des azalées luit sourdement à travers le brouillard couleur de perle; le ciel diffuse une clarté blanche et les rues sont sans fond; l’air moite colle à la peau et l’odeur des feuilles mortes oppresse la terre. Nous nous arrêtons dans un petit bar et tout en buvant des whiskies nous parlons jusqu’à l’aube. R. s’enivre de paroles, il dit que c’est si rare en Amérique de pouvoir parler. Il nous accompagne jusqu’à l’hôtel. Le hall si superbe pendant la journée n’est plus qu’une salle d’attente morose; un homme lave le carrelage qui répand une odeur de savon; il fait sombre; dans un fauteuil, un vieillard dort, la bouche entr’ouverte. Nous faisons nos adieux au petit Italien, dont sans doute rous ne connaftrons jamais le destin et il nous dit d’un air approbateur: «C’est rare de trouver à causer dans ce pays.» Nous répondons: «C’est rare de trouver un Américain de votre espèce.» Il sourit: «Oh! je sais: je suis un “caractère”.» Je voudrais bien le retrouver dans dix ans.
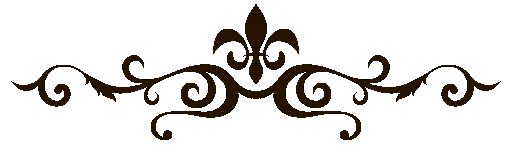
1er avril.
Ce matin, je me suis fait conduire en taxi, au hasard, loin du centre de la ville, et j’ai marché pendant des heures à travers de calmes banlieues; sur les palmiers, sur les azalées roses et les corbeilles de grosses fleurs rouges, le vent soufflait, âpre comme une vengeance et de temps à autre la pluie s’abattait en brefs sanglots. Les vieilles maisons romantiques semblaient aussi fragiles que les fleurs: l’eau s’infiltrait dans les murs de bois couleur vert-de-gris et les planches pourrissantes semblaient prêtes à s’effriter comme au milieu des forêts tropicales les troncs d’arbres rongés par les intempéries. Cet après-midi, comme le professeur S. et sa femme me promenaient en auto, le déluge s’est déchaîné. Je n’avais jamais vu tomber la pluie. C’était une révolte du ciel, une convulsion mortelle de la terre. Le monde sanglotait avec une violence désespérée, sanglotait à mourir, sachant qu’on n’en peut pas mourir et qu’il restera toujours autant de larmes à verser. Arrêtés contre le trottoir, devant une vieille maison que nous voulions visiter, il nous était impossible de descendre et de franchir les deux mètres qui nous séparaient du seuil. Il était également impossible de rouler. En vain, l’essuie-glace s’affolait: les vitres ruisselaient, le paysage se craquelait et tremblait comme sur l’écran dans la seconde où le héros se sent mourir. On attendait l’éclatement d’une nuit définitive où le monde se fût engouffré. Mais la nuit n’est pas venue. Brusquement, vers 5 heures, la pluie s’est arrêtée; on eût dit que les larmes mêmes et la révolte étaient devenues inutiles: au fond du ciel d’un jaune fixe, le dernier espoir était mort; les fleurs, les arbres, les maisons baignaient dans une grande lumière de fin du monde. Plus tard, la nuit quotidienne est tombée.
J’ai visité l’intérieur de quelques vieilles maisons, touché la dentelle verte des fers forgés. Le soir, après ma conférence, le professeur S. a réuni chez lui quelques collègues. Sa fille, âgée de quinze ans, et qui cultive avec soin une lointaine ressemblance avec Bette Davis, se promenait pieds nus et en slacks dans le salon: elle s’est habillée pour aller au cinéma avec son date: dans sa fraîcheur naïvement sophistiquée, dans sa grâce vivante et libre, comme elle était différente des filles de professeurs de chez nous! Mais même dans ce foyer souriant, chez ces intellectuels naguère libéraux, la terreur rouge a pénétré. «Il y a encore quelques mois, disent S. et ses amis, nous pensions qu’une démocratie se doit de respecter toutes les opinions. Mais nous comprenons qu’elle doit réprimer celles qui sont néfastes à la démocratie même.» La propagande est bien faite. Voici quatre jours, le leader de la FBI. a déclaré à son tour que les Rouges devaient être assimilés à une cinquième colonne; et le mot «Rouge» est des plus élastiques. Chez les ouvriers comme chez les bourgeois, chez les intellectuels comme chez les politiciens, le sens de la liberté se perd de jour en jour.
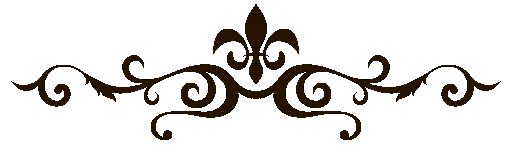
2 avril.
À travers ses orages, son soleil, ses nuits moites, à travers son printemps gris perle à l’odeur d’automne, New Orleans nous a semblé digne de ses plus fabuleuses légendes. Je sais que c’est aussi une des villes les plus misérables d’Amérique, une de celles où la vie est la plus âpre; déjà son luxe croupi nous a paru ambigu; on voudrait pénétrer plus avant dans son cœur, on voudrait y vivre dans la vérité d’une vie quotidienne. En partant, je pense avec résolution: j’y reviendrai.
C’est une longue traversée que nous entreprenons aujourd’hui. L’autobus part le matin à 9 heures, il sera à Jacksonville à 2 heures dans la nuit. C’est un «rapide» qui ne s’arrête que deux ou trois fois. On y vend des sandwiches, du cocacola; les dossiers des fauteuils sont mobiles et la nuit chacun peut allumer une petite lampe individuelle, comme dans les avions. Et le steward nous gratifie de souhaits encourageants; de temps à autre, il fait le point, annonce les prochains arrêts et explique les paysages. Nous traversons la Louisiane, le Mississipi, l’Alabama, la Floride. Les bras du Delta sont vastes comme des lacs, ils étincellent dans le soleil et le golfe du Mexique est bleu comme un rêve pour lunes de miel. Palmiers, cactus, azalées, villes en fleurs, forêts tropicales aux végétations lourdes, maisons romantiques poussant au milieu des gazons tranquilles et cabines délabrées dans la solitude des bois, mer éblouissante, lagunes languissantes, mousses espagnoles luxueuses et sordides, c’est tout le Sud aux contrastes pathétiques qui s’offre au long de la journée. Et tout au long du jour la grande tragédie du Sud nous poursuit comme une obsession. Même le voyageur cantonné dans un autobus et dans des salles d’attente ne peut pas y échapper. Depuis que nous sommes entrées au Texas, partout où nous passons, il y a une odeur de haine dans l’air: haine arrogante des blancs, haine silencieuse des noirs. Aux stations, les petitesbourgeoises décentes et mal vêtues, dévisagent avec une colère envieuse les jolies filles noires aux robes éclatantes, aux bijoux joyeux; et les hommes ressentent la beauté nonchalante des jeunes noirs aux complets clairs. La gentillesse américaine n’a plus de place ici; dans la queue qui se presse aux portes du bus, on bouscule les noirs: «Vous n’allez pas laisser cette négresse passer devant vous», dit une femme à un homme, avec une voix tremblante de fureur.
Les noirs s’entassent humblement sur la banquette du fond, ils essaient de se faire oublier. Au milieu de l’après-midi, dans la chaleur et les cahots qui sont particulièrement rudes à l’arrière, une femme enceinte s’évanouit; sa tête abandonnée cogne contre la vitre à chaque sursaut; nous entendons la voix ricanante et scandalisée d’une college-girl qui crie: «La négresse est folle!» Le conducteur arrête l’autobus et il va voir ce qui se passe; ce n’est qu’une négresse évanouie, et tout le monde ricane: il faut toujours que ces femmes fassent des embarras… On secoue un peu la malade, on la réveille et l’autobus repart; nous n’osons pas lui offrir notre place à l’avant, tout le car s’y opposerait et elle serait la première victime de l’indignation provoquée. L’autobus continue à rouler, la jeune femme à souffrir et, quand on s’arrête en ville, elle est évanouie de nouveau; les gens vont boire des coca-cola sans s’occuper d’elle; il y a seulement une vieille Américaine qui vient avec N. et moi essayer de lui porter secours. Elle nous remercie, mais elle a l’air inquiet et elle sen va au plus vite sans accepter que nous l’aidions davantage: elle se sent coupable aux yeux des blancs et elle a peur. Ce n’est qu’un petit incident. Mais il m’aide à comprendre pourquoi, quand nous traversons les faubourgs où s’entasse une population noire, ce sont des regards si farouches qui se posent sur le placide Greyhound.
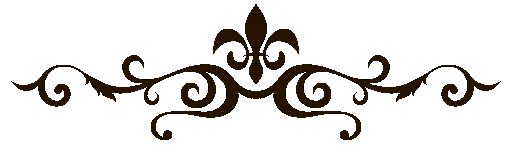
3 avril.
Entre Jacksonville et Savannah, ce matin, N. s’est assise faute d’autre place aux côtés d’un jeune noir; dès qu’un siège a été libre du côté des blancs, il le lui a désigné: «Je suppose que vous préférez ne pas rester ici», a-t-il dit sèchement; celle de ce soir sont très rares. Les parties représentent une obligation sociale à laquelle on se plie de temps à autre mais on n’y cause pas plus qu’on ne s’y distrait et il est très rare que les écrivains s’y retrouvent entre eux. À Paris, la vie littéraire finit parfois par prendre le pas sur la littérature même, ce qui n’est pas un bien; mais l’absence de toute vie littéraire est un mal encore plus débilitant. On comprend que Hollywood et tous les mirages de la facilité tentent dangereusement l’écrivain doué; on comprend que ceux qui créent dans la peine se découragent. Il faut beaucoup d’ascétisme et de vigueur pour «tenir» longtemps. C’est ce qui explique un phénomène qui m’a longtemps paru déconcertant: que tant d’écrivains après un livre très bon ou tout au moins plein de promesses se soient tus définitivement. On peut citer de longues listes de ces enfants uniques. Ils sont une des preuves les plus saisissantes des possibilités qu’on trouve en ce pays chez les individus pris un à un et de la manière dont la civilisation américaine les tue.
Nous écoutons du vieux jazz: des Louis Armstrong de la grande époque, des airs de Bessie Smith, la chanteuse noire qui mourut des suites d’un accident d’automobile parce qu’on refusa de l’admettre dans un hôpital blanc; nous entendons aussi une musique folklorique plus ancienne que le jazz: les chants de funérailles qui se chantaient à New Drleans:kes refrains de travail chantés au temps de l’esclavage par les noirs des plantations. Entre deux morceaux, nous discutons sur la littérature américaine. Beaucoup de problèmes se posent aux jeunes romanciers. La génération précédente a forgé un excellent instrument et s’en est servie avec bonheur; en substituant le behaviorisme à l’analyse, elle n’a pas appauvri la psychologie comme on le prétend parfois; la vie intérieure d’un homme n’est pas autre chose que son appréhension du monde; c’est en se tournant vers le monde et en laissant dans l’ombre la subjectivité du héros qu’on réussit à l’exprimer avec le plus de vérité et de profondeur; elle est indiquée en creux à travers les silences, d’une manière bien plus savante que par les bavardages des mauvais disciples de Proust; et ce parti pris d’objectivité permet de manifester le caractère dramatique de l’existence humaine. Cependant, la richesse des implications n’est pas la même chez tous les auteurs de cette école; chez les médiocres, le procédé devient mécanique et rien n’est plus indiqué que du vide. De toutes façons ces techniques ne sauraient, pas plus qu’aucune autre, tout exprimer. On comprend que les jeunes ne veuillent pas refaire du Hemingway, du Dos Passos. Ils cherchent. N. G., qui est admirateur et disciple de Farrel, a écrit un récit tout objectif; il ne comprend pas que nous lui reprochions d’être souvent plus documentaire que romanesque; il nous semble aussi que les conduites de ses personnages sont parfois injustifiées, qu’il s’autorise du point de vue choisi pour escamoter le problème des motivations psychologiques. Il se défend avec feu et il défend l’esthétique à laquelle il se rallie. A. E. sent au contraire le besoin d’une autre forme d’art; il est de ceux à qui un roman bien construit, bien conduit, ne semble plus satisfaisant; il estime impossible de rendre la totalité d’un être humain dans son immanence et sa transcendance, dans ses entours et dans sa solitude, sans inventer de nouveaux procédés. C’est parce qu’ils sentent les manques du roman tel que l’ont créé leurs aînés que beaucoup de jeunes choisissent aujourd’hui la poésie. Et il y a des prosateurs qui cherchent à intégrer la poésie dans leurs œuvres; l’influence du surréalisme et du monologue intérieur à la manière de James Joyce est très significative. Le débat se prolonge jusqu’à 2 heures du matin, et nous le poursuivons encore en descendant vers notre hôtel, le long de Central Park, par une douce nuit printanière.
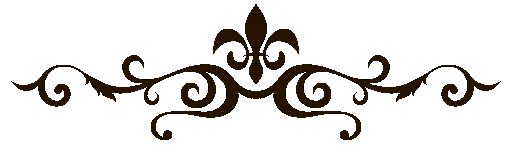
11 avril.
Je montre à N. la Bowery, le quartier juif, le quartier chinois. Nous allons à un cocktail chez nos amis L. et, après un dîner dans un restaurant français, A. E. nous emmène entendre sur la 52€ Rue le trompette Sydney Bechet. C’est un des derniers musiciens qui joue dans le pur style de la il a été célèbre en Amérique, il a joué aussi en France; à Paris, il a tué un autre musicien noir au cours d’une rixe; il a fait une année de prison au cours de laquelle ses cheveux sont devenus tout blancs; c’est aujourd’hui un vieil homme au visage raviné. Un pianiste l’accompagne. Ce n’est pas une attraction suffisante: le petit night-club est désert. Il y a seulement trois jeunes gens à une table voisine qui écoutent avec passion: ils sont sans doute de la même espèce que le petit Italien de New ils écoutent comme d’autres prient. Mais Bechet ne pourrait rêver un public plus digne de son génie que la femme au visage noir, au tablier blanc qui apparaît de temps à autre par une petite porte, derrière l’estrade. C’est sans doute la cuisinière; c’est une forte femme d’une quarantaine d’années au visage fatigué mais habité par de grands yeux infatigables; les mains posées à plat sur son ventre, elle est tendue vers la musique avec une ardeur religieuse; peu à peu sa face usée se transfigure, son corps indique le rythme d’une danse, elle danse, immobile, et la paix et la joie sont descendues sur elle; elle a des soucis, elle a eu des malheurs, elle oublie soucis et malheurs, elle oublie ses torchons, ses enfants, ses maladies; sans passé, sans avenir, elle est comblée: la musique la justifie à travers toute sa vie difficile, et le monde est justifié avec elle; elle danse, immobile, avec un sourire des yeux inconnu des visages blancs où seule la bouche grimace la gaieté; et en la regardant on comprend mieux encore la grandeur du jazz qu’en entendant Bechet même.
Que les Américains blancs comprennent de moins en moins le jazz, c’est évident. Ils n’en font pas du tout, comme je le croyais, leur pâture quotidienne. Il y a ici une institution redoutable qui s’appelle «Music by Musak» et qui débite de la musique à qui en fait la commande, à n’importe quelle heure de la journée; ils ont plusieurs espèces de programme: pour funeral-home, pour fiançailles et mariages, pour cocktails-parties, pour bars et restaurants; dans les usines aussi des flots de musique sont répandus à travers les ateliers pendant que les ouvriers travaillent. Et chaque endroit public possède son juke-box. L’Américain, quand il mange, travaille, se repose, à tout instant de sa journée, et même en taxi grâce à la radio, baigne dans la musique: il y en a qui vont jusqu’à transporter à la main des radios portatives dont le prix est dérisoire. Mais ce qu’on lui sert, ce n’est jamais du jazz: c’est du Sinatra ou du Bing Crosby, ce sont ces mélodies sucrées qu’on appelle sweet music et qui sont aussi douceâtres que les sweet potatoes. C’est de la sweet music qu’on offre le plus souvent dans les boîtes à succès, ou encore un sweet jazz qui est un abâtardissement du jazz. Le public aime les grands orchestres spectaculaires où il n’est possible de jouer que de la musique écrite. Ce qui est plus grave, c’est que ceux mêmes qui prétendent aimer le vrai jazz le dénaturent; et comme les noirs ne gagnent leur vie que par la clientèle des blancs, ils se font nécessairement complices de cette perversion. Quand on compare Bechet, ou les petits orchestres de New DrleansiJou les vieux disques d’’Armstrong et Bessie Smith avec le jazz qui est en vogue aujourd’hui, on se rend compte que les Américains ont peu à peu vidé cette musique brûlante de tout son contenu humain et sensible. Deuil, travail, sensualité, érotisme, joie, tristesse, révolte, espoir, la musique noire exprimait toujours quelque chose, et le hot était la forme fiévreuse et passionnée de cette expression; le présent y était exalté dans sa vérité concrète, c’est-à-dire alourdi par le poids d’un sentiment, d’une situation, lié à un passé et à un avenir. Les Américains se détournent avec mépris du passé («Comment, vous vous intéressez encore au vieux Faulkner?» me disait avec scandale un éditeur) — l’avenir collectif est dans les mains d’une classe privilégiée, la pullman class à qui est réservée la joie d’entreprendre et de créer sur de grandes échelles; les autres ne savent pas s’inventer, dans le monde d’acier dont ils sont les rouages, un avenir singulier: ils n’ont ni projet, ni passion, ni nostalgie, ni espoir qui les engage au-delà du présent; ils ne connaissent que la répétition indéfinie du cycle des saisons et des heures. Mais coupé du passé et de l’avenir, le présent n’a plus de substance; il n’est rien; c’est un pur maintenant vide. Et parce qu’il est vide il ne peut s’affirmer que par des moyens extérieurs: il faut qu’il soit «excitant». Ce qui plaît aux Américains dans le jazz, c’est que le jazz mabe-bonifeste l’instant; mais comme pour eux l’instant est abstrait, c’est aussi une manifestation abstraite qu’ils réclament; ils veulent du bruit, des rythmes, rien de plus; il se peut que bruits et rythmes soient orchestrés avec art, avec science, de manière qu’indéfiniment le présent renaisse de sa mort: mais le sens du vieux jazz est perdu. A. E. me dit que la forme la plus récente du jazz, le be-bop, manifeste encore plus clairement cette divergence. Originellement, il s’agit d’un hot poussé à son point le plus extrême, c’est un effort pour exprimer le quiver, la palpitation de la vie, dans ce qu’elle a de plus fragile et de plus fiévreux. Mais de cette fièvre intérieure les blancs ont fait, et les noirs à leur suite, une trépidation tout extérieure; ils n’ont gardé que des rythmes d’une précipitation haletante mais qui ne signifient plus rien. Un tel passage à l’abstraction n’est pas limité au domaine du jazz. En parcourant à nouveau les galeries de tableaux, en lisant certains ouvrages de jeunes, j’ai été frappée par la généralité du phénomène. Le cubisme, le surréalisme ont été vidés eux aussi de leur contenu. On n’en garde que le schéma abstrait. Ces formes qui ont été en Europe des langages vivants et qui se sont détruites par le mouvement même de leur vie, on les retrouve ici intactes mais embaumées; on les produit et les reproduit mécaniquement sans s’apercevoir qu’elles ne disent plus rien. Dans ce pays si ardemment tourné vers des civilisations concrètes, ce mot: abstraction, me revient chaque jour aux lèvres. Il faudra que j’en comprenne plus exactement les raisons.
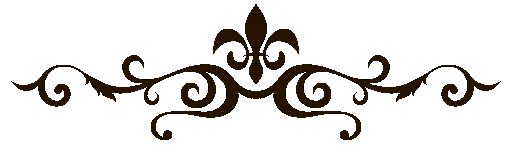
Text prepared by:
- Bruce R. Magee
Source
de Beauvoir, Simone. L’Amérique au jour le jour. Paris: Editions Gallimard, 1997. Internet Archive, 6 July 2021, https:// archive.org/ details/ lamerique aujourl 0000beau/ Accessed 22 Aug. 2025.
